Cabinet Avi Bitton
Avocats & Associés

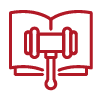

Clients conseillés et défendus
Cabinet d’Avocats Avi Bitton Associés
Droit du Travail · Droit Pénal · Préjudice Corporel
Cabinet d’avocats Avi Bitton - 10 avocats et juristes - 20 ans d'expérience - Plus de 4 000 clients :
- Cadres, cadres supérieurs et cadres dirigeants,
- Victimes d'agressions et accidents,
- Accusés de crimes et délits.
Affaires médiatisées : Carlos Ghosn, Altice, HSBC Falciani, attentat de la rue des rosiers, ….
Interventions médias chaines télévisées (TF1, France 2, France 24, BFM TV …), presse nationale (Le monde, Le Figaro, Libération, Les Echos, ...), régionale (Ouest France, Nice Matin, ...) et internationale (Wall Street Journal, The Guardian, The Lawyer, ...) sur affaires judiciaires : Nicolas Sarkozy, Dominique Strauss-Khan, Cédric Jubillar, Karim Benzema, Ary Abittan, Benjamin Griveaux, ....
- Ancien Membre du Conseil de discipline de l'Ordre des Avocats de Paris (2013, 2018 à 2023).
- Ancien Membre du Conseil de l’Ordre des Avocats (2010-2015)
- Ancien Membre du Conseil National des Barreaux (2012-2015).
- Auteur de l'ouvrage "Le procès au Conseil de Prud'hommes", publié par LGDJ, un des principaux éditeurs juridiques (2018).
Avi Bitton est régulièrement consulté par le Gouvernement (Ministère de la justice, Ministère du travail, Assemblée nationale, Sénat ...) sur des réformes en droit du travail et en droit pénal.
Activité internationale pour clients privés (particuliers expatriés, entreprises étrangères, ...) ou institutionnels (ambassades, consulats, ...) avec implications aux Etats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Suisse, dans l'Union européenne (Portugal, Italie, Allemagne ...), en Russie, au Brésil, en Israël, au Maroc ou au Rwanda.
Cabinet recommandé par classements français et internationaux Best Lawyers, Décideurs et Legal 500.
Collaboration avec anciens juges, magistrats et conseillers prudhommaux, agents privés de recherche dits détectives privés (recherches de biens à saisir à l’étranger, identification de témoins, ...), experts (experts judiciaires en écriture, experts scientifiques, experts médicaux, experts en toxicologie ...) et huissiers de justice (saisies de comptes bancaires, ...).
Cabinets d’avocats correspondants à l’international : Grande-Bretagne (Londres), Italie (Milan), Lettonie (Riga), Ukraine (Kiev), Roumanie (Bucarest) et en Bulgarie (Sofia), et en région : Lyon, Toulon et Rouen.
Langues parlée : anglais et portugais.
Contactez le Cabinet Avi Bitton Avocats & Associés
Vous êtes cadre et vous avez besoin de conseils en droit du travail ?
Cliquez ici pour compléter le formulaire de contact
Vous êtes accusé d’un crime ou délit ?
Cliquez ici pour compléter le formulaire de contact
Vous êtes victime d’un accident ou d’une agression ?
Cliquez ici pour compléter le formulaire de contact
Avocats & Juristes
Ans d'expérience
Clients conseillés et défendus
Classements et recommandations du cabinet Avi Bitton Avocats & Associés
Le cabinet Avi Bitton Avocats & Associés est recommandé en droit du travail par le classement international Best Lawyers pour les années 2020 et 2021. Il est aussi recommandé par le classement international Legal 500 en droit du travail et en droit pénal. Selon le classement international Legal 500 :



Avi Bitton et associés est doté d’une équipe très réactive, capable de fournir des conseils astucieux et d’anticiper la défense adverse dans des contentieux sensibles, notamment en droit pénal du travail. Le cabinet est très présent aux côtés des cadres salariés de grandes entreprises et affiche un taux de réussite très important dans les contentieux qu’il traite. L’équipe développe également sa base de clientèle d’entreprises. L’équipe compte dans ses rangs : Avi Bitton, un esprit stratège, combatif et passionné par le droit du travail qui montre une réelle empathie pour venir en aide à ses clients, Laetitia Lencione. Le cabinet est enfin un recours combatif pour des causes délicates et difficiles au pénal avec Avi Bitton et Nelson de Oliveira.
Le Cabinet d’avocats Avi Bitton & Associés a aussi été recommandé par les classements Best Lawyers et Leaders League (magazine Décideurs) pour les contentieux à risque.
Secteurs d’intervention
Le cabinet Avi Bitton Avocats & Associés intervient dans toute la région parisienne, à savoir dans les départements et les barreaux de Paris (75), de Seine-et-Marne (77), des Yvelines (78), de l’Essone (91), des Hauts-de-Seine (92), de Seine-Saint-Denis (93), du Val-de-Marne (94) et du Val-d’Oise (95). Le cabinet plaide régulièrement des affaires devant la cour de Paris, Créteil, Bobigny, Nanterre, Boulogne, Evry, Longjumeau, Montmorency, Versailles, Meaux et Melun, ainsi que devant le tribunal judiciaire de Paris, Nanterre, Bobigny, Evry, Versailles, Melun et Meaux.

